Cet article est extrait des "Indispensables" de Sciences et Avenir n°202, dédié à la thématique de "l'infini", en vente en kiosque de juillet à septembre 2020.
Michel Blay est historien des sciences, directeur de recherche honoraire au CNRS et président du Comité pour l'histoire du CNRS.
Sciences et Avenir : Est-il possible de penser l’infini ?
Michel Blay : Je crois que cette expression n'a pas de sens. On peut penser "avec" l'infini, ce dernier étant alors un outil, celui qui a permis de construire des objets notamment mathématiques depuis le 17e siècle. On peut aussi penser "à partir" de l'infini, comme le fait par exemple Descartes : il distingue l'infini, qui est le nom de Dieu, et l'indéfini, le monde dans lequel nous vivons. Mais l'infini en lui-même, comment peut-on le penser, en dehors de la pure mathématique ?
L’infini aurait donc une histoire ?
Absolument. Ne pensons pas que ce terme désigne la même chose des Grecs à nos jours ! Il faut bien distinguer l'infini comme totalité du monde et l'infini qui permet de faire des mathématiques, deux notions qui n'ont été séparées qu'au 17e siècle. La première réflexion sur l'infini nous vient des Grecs, et remonte à la naissance de la philosophie. Avant même Socrate. Le philosophe, en effet, est celui qui interroge le monde en tant qu'existant : qu'est-ce qui est ? Que signifie être ? Qu'est-ce que cette totalité où je suis ? C'est une réflexion extrêmement abstraite, qui est la question grecque, ou occidentale, par excellence. Dans les autres civilisations, c'est le mythe qui rend compte de la totalité.
Au milieu du 6e siècle avant Jésus-Christ, donc, le philosophe Anaximandre de Milet écrit un traité sur la nature dans lequel il introduit le terme apeiron, l'illimité. Ce n'est pas exactement l'infini, mais un principe général de fabrication du monde, ce dont tout dérive et revient. Puis, par la suite, Platon ou Aristote se représenteront le mouvement des astres comme une ronde sans fin dans un monde clos, le temps n'ayant ni début ni terme. Pour eux, la nature, dans son principe interne de génération et de corruption, cyclique, se produit indéfiniment. Il y a donc en Grèce un jeu de l'infini, ou plutôt de l'indéfini, et du fini.
Qui dit infini, en Occident, évoque aussitôt le Dieu des monothéismes…
Avec le christianisme, le Dieu créateur récupère en effet la notion d'infini, qui est un de ses multiples attributs. Un infini absolument transcendant, qui n'a rien à voir avec celui des mathématiques ou de la cosmologie… Jusqu'au théologien Nicolas de Cues (1401-1464), dit le Cusain, qui précise qu'en Dieu se réalise la coïncidence des opposés, du fini et de l'infini. Disant cela, il rompt avec le principe de non-contradiction d'Aristote selon lequel une chose ne peut pas à la fois être et ne pas être. Pour le Cusain, ce principe est vrai dans l'ordre de la raison et de la logique, mais plus dans l'ordre de l'intellect divin. Cette idée ouvre quelque chose de tout à fait nouveau sur le statut de l'infini et de Dieu, statut qui se précisera quelques décennies plus tard avec Giordano Bruno.
Celui-ci n'est pas du tout, comme on le dit parfois, un père de l'athéisme ou de la laïcité ! Profondément croyant, il ne voit pas pourquoi Dieu aurait créé un monde fini alors que sa puissance est infinie. On ne conserve de lui, en général, que l'idée d'infini en extension et en grandeur, c'est-à-dire géométrique, et celle de pluralité des mondes. Mais il introduit d'autres infinis, par exemple comme présence de Dieu dans chaque être, chaque être étant en lui-même infini.
Selon vous, c’est donc le 17e siècle qui marque la rupture dans cette question de l’infini ?
Deux personnalités vont jouer un rôle majeur. Galilée, d'une part, qui transforme le monde en monde mécanique. C'est l'ingénieur, pour qui tout est machine. Et Descartes, d'autre part, qui se pose la question : comment admettre un monde mécanique et en même temps justifier de la présence de Dieu ? Il s'en sort d'une manière assez maligne : il pose que Dieu est l'infini alors que le monde est mécanique et indéfini, c'est-à-dire aussi grand que l'on veut sans être infini, car dépendant de l'infini divin. Mais aussitôt se pose un problème : si l'infini est le nom de Dieu, comment l'utiliser en mathématiques ? Donc... il ne l'utilise pas en mathématiques ! Tout le 17e siècle est dans ce jeu visant à protéger la transcendance : la métaphysique essaie de construire quelque chose, la science également, les deux sphères se pensant en harmonie. C'est Fontenelle qui, en 1728, opérera la vraie séparation dans ses "Éléments de la géométrie de l'infini". Il le dit très clairement : il y a deux infinis, l'infini géométrique, celui qui permet de faire de la physique et des mathématiques, et qui n'a à rendre compte que de lui-même. Et un deuxième qui correspond à la totalité… Celui-là est très obscur, on ne va plus s'en occuper. Cela libère totalement la pensée de l'infini mathématique et va permettre des réussites admirables aux 18e et 19e siècles, jusqu'à Cantor.
C’est formidable…
C’est un tournant absolument central dans la constitution de notre pensée moderne : désormais, la philosophie peut discuter avec la religion, la science, non… si ce n’est pour des questions de pouvoir. Les penseurs ont alors l’impression d’être libérés des questions métaphysiques. Le 18e est un siècle magnifique, avec une certaine innocence, un certain optimisme, un certain bonheur.
Mais en réalité, les questions fondamentales demeurent ! Blaise Pascal, qui s’était posé à la même époque que Descartes la question de l’infini, l’avait bien vu. Et il a choisi de dire : "Je suis un excellent mathématicien, mais que me dit ma vie ? Que je dois être du côté de Dieu, de l’infini. J’abandonne donc la physique." Il a donné plus d’importance à son être même, au sens de sa vie, qu’aux résultats expérimentaux de la science.
Pourquoi est-ce si fâcheux d’avoir abandonné l’infini comme totalité ?
Tout simplement parce qu’il n’y a plus de lien entre la préoccupation philosophique et la construction mathématique du monde. Avoir le souci de la totalité, c’est se questionner sur le sens de ce que l’on fait. Mais aussi sur sa responsabilité. Quel rapport entre faire de la physique et l’existence de la totalité du monde ? Cet abandon de la totalité a mené les scientifiques à succomber à l’hubris de la technique. Contrairement aux Grecs, qui séparaient nettement nature et technique, on croit depuis Galilée et Descartes - de façon très illusoire - que la nature est une machine, donc que l’homme est une machine. Une hypothèse fort intéressante, mais qui conduit à ce que la nature devienne notre objet. Notre hubris de mécanistes finit par tout détruire.
L’infini comme totalité nous serait donc inaccessible aujourd’hui ?
Non ! On peut en faire simplement l’expérience. Regardez un arbre. Il est là, fini. Approchez-vous : vous voyez les feuilles, les branches, l’écorce, de petits animaux, etc. Plus vous vous approchez, plus il devient infini, présent, vivant, là, pour vous. Le concept d’arbre est fini, mais cet arbre-là, dans l’ici et maintenant, lui, est infini. Ainsi, on peut voir l’infini dans le fini. Cela donne un poids existentiel à ce qui nous entoure. Avec cet exemple de l’arbre, j’essaie de faire sentir qu’il y a de l’existence, une existence infinie. Et qu’il faut essayer de se désintoxiquer des concepts.
Vous diriez que la science est un échafaudage de concepts ?
Mais oui ! Seulement, nous vivons dans un tel montage conceptuel que nous avons l’impression qu’il est la réalité. Prenez Newton, par exemple, quand il construit le concept t : un temps qui s’écoule uniformément, celui qui a permis la mécanique. Personne ne vit un temps de cette sorte ! Notre temps est une intériorité. Le temps de Newton ne commence pas, ne s’arrête pas. Le nôtre, nous le savons, va s’arrêter à un moment donné. Nous ne sommes pas éternels, nous sommes dans la finitude. Et c’est à cela qu’il faut revenir.
Propos recueillis par Dominique Leglu, Florence Leroy et Vincent Rea
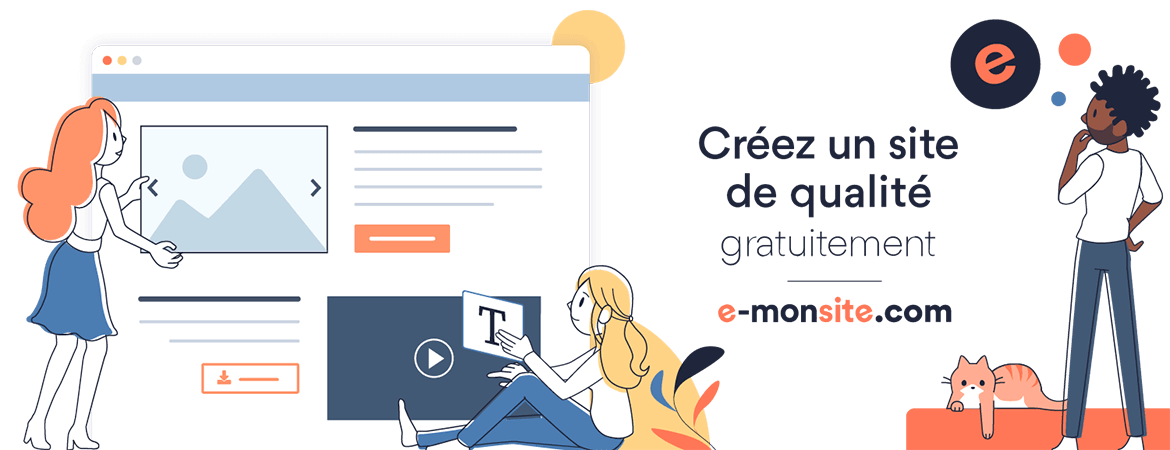
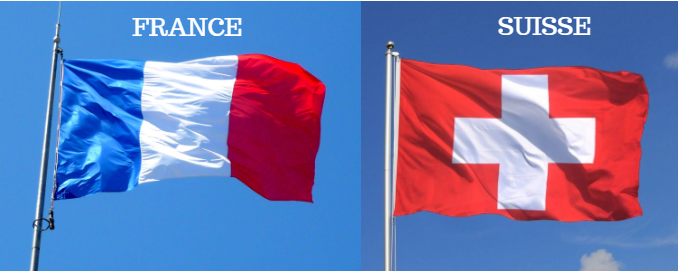












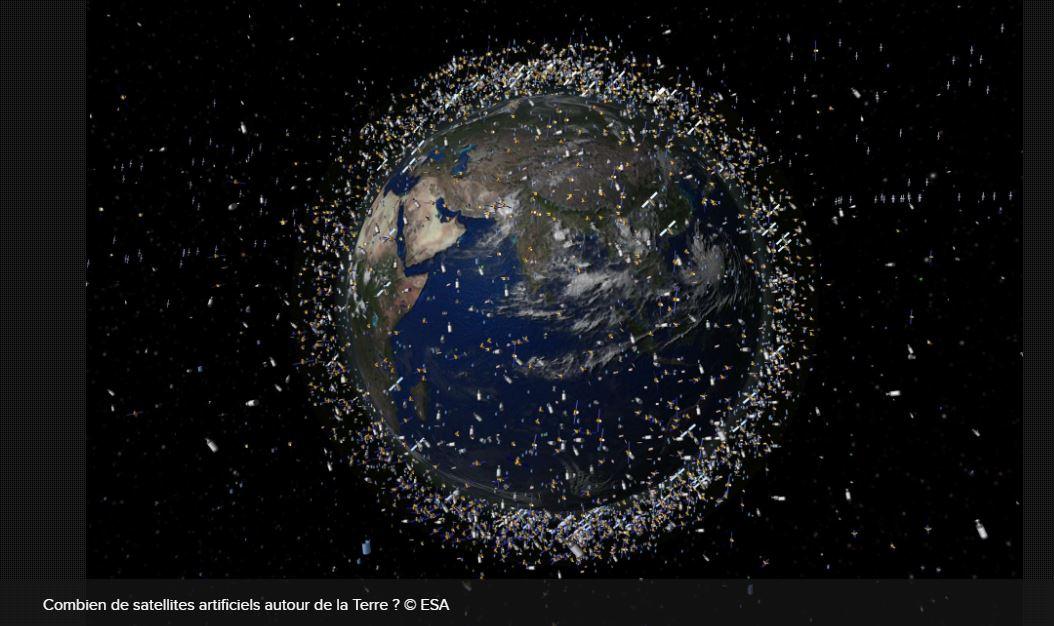

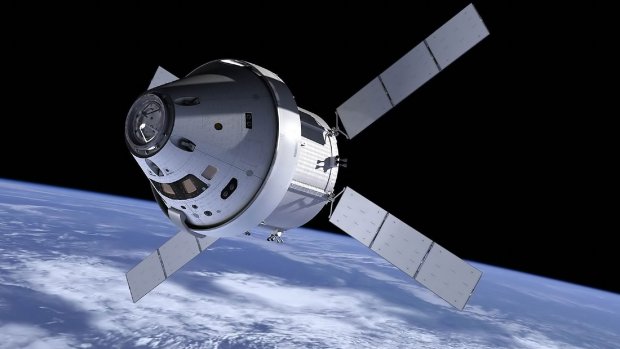


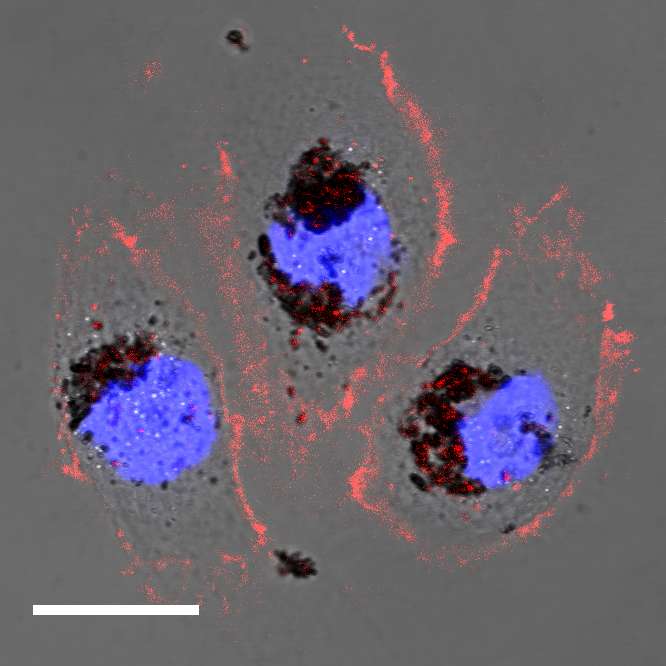


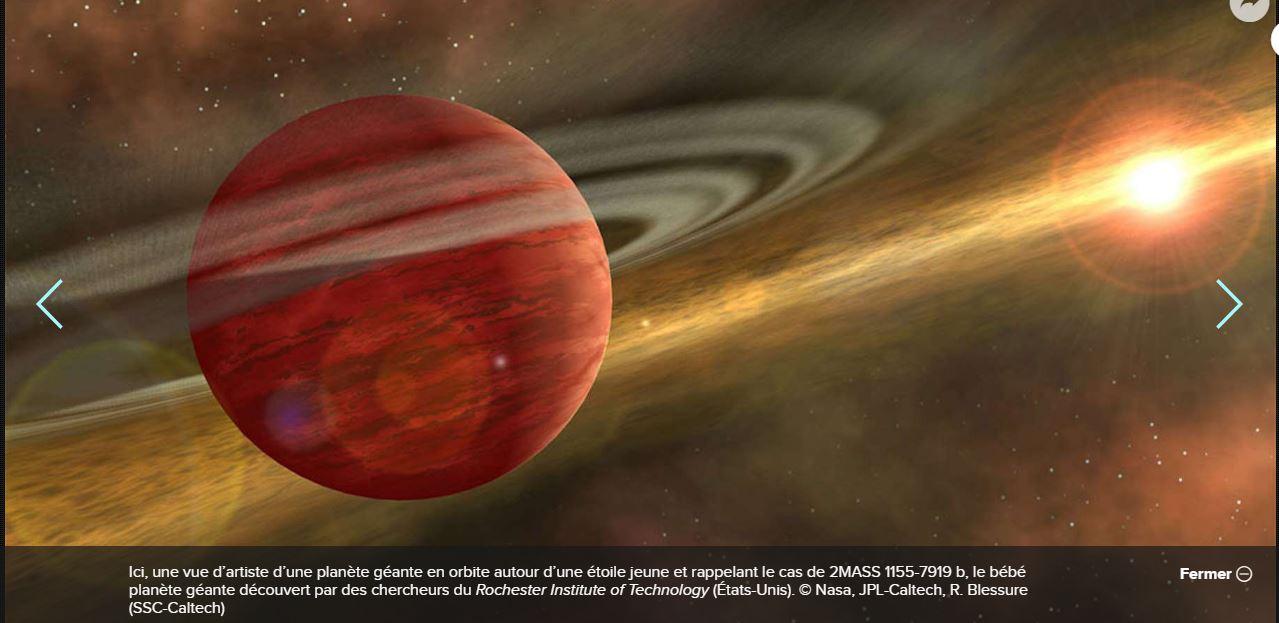











 Français
Français
 English
English
 Español
Español
 Italiano
Italiano
 Deutsch
Deutsch
 Nederlands
Nederlands
 Portuguesa
Portuguesa
 Swedish
Swedish
 Romanian
Romanian
 Polish
Polish
 Norwegian
Norwegian
 Finnish
Finnish
 Bulgarian
Bulgarian
 Danish
Danish
 Czech
Czech
 Croatian
Croatian
 Hindi
Hindi
 Russian
Russian
 Chinese (Simplified)
Chinese (Simplified)
 Japanese
Japanese
 Arabic
Arabic



